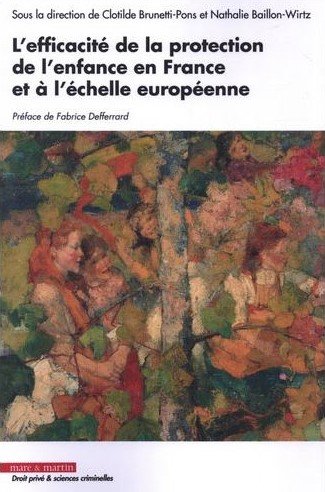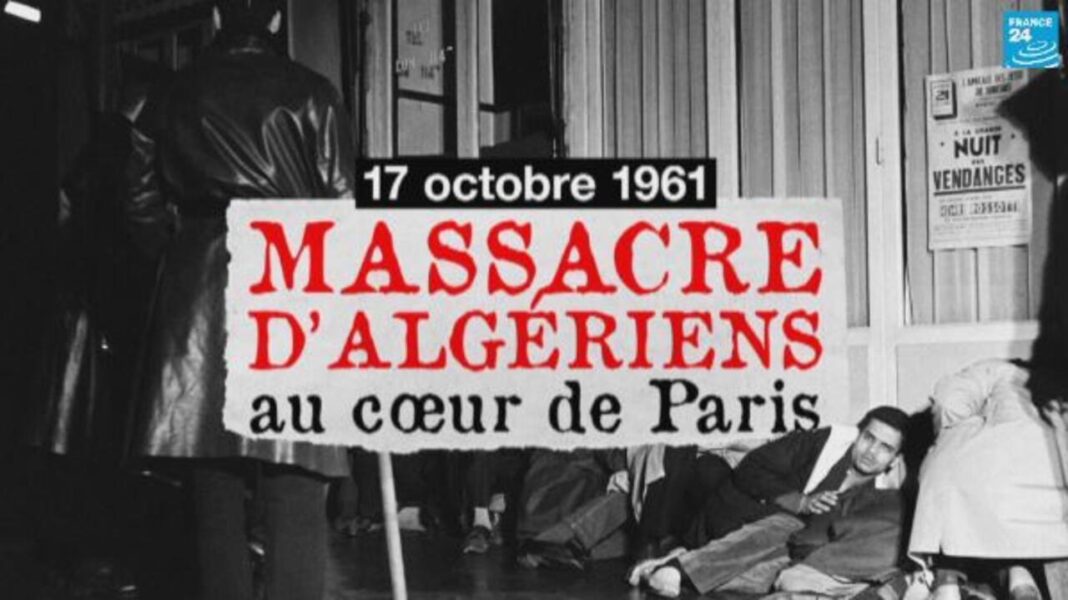L’ouvrage L’efficacité de la protection de l’enfance en France et à l’échelle européenne, publié aux éditions Mare & Martin, constitue une contribution majeure à la réflexion contemporaine sur les dispositifs de protection de l’enfance.
Dirigé par Clotilde Brunetti-Pons et Nathalie Baillon-Wirtz, deux professeures de droit reconnues pour leurs travaux sur la famille, la filiation et la vulnérabilité des mineurs, L’efficacité de la protection de l’enfance en France et à l’échelle européenne est un livre collectif qui s’inscrit dans le prolongement des recherches menées au sein du CEJESCO (Centre d’études juridiques sur l’efficacité des systèmes continentaux) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Fruit d’un programme de recherche approfondi, conduit entre 2022 et 2024, l’ouvrage réunit les analyses et réflexions d’un large éventail de spécialistes : universitaires, magistrats, médecins, psychiatres, sociologues et acteurs de terrain. Cette pluralité d’approches témoigne d’une volonté affirmée de croiser les regards juridiques, sociaux, médicaux et humains pour appréhender dans toute sa complexité le fonctionnement des dispositifs de protection de l’enfance.
Au-delà de la stricte évaluation juridique, ce projet adopte une démarche pluridisciplinaire et comparée, s’intéressant non seulement au système français, mais aussi à plusieurs modèles européens, notamment allemand, italien, espagnol, luxembourgeois et britannique. Cette ouverture internationale permet de mettre en lumière les forces et faiblesses du modèle français, tout en identifiant des pratiques inspirantes susceptibles d’enrichir la réflexion nationale.
Ainsi, l’ouvrage L’efficacité de la protection de l’enfance en France et à l’échelle européenne ne se limite pas à un constat critique : il offre un outil d’analyse et de prospective, articulant rigueur scientifique et souci d’efficacité pratique. Il illustre la capacité du droit, lorsqu’il se nourrit du dialogue entre disciplines, à redevenir un instrument vivant au service de l’enfant, de sa sécurité, de son éducation et de son épanouissement.
L’édition, d’un grand sérieux académique, s’inscrit dans la prestigieuse collection Droit privé & sciences criminelles des éditions Mare & Martin, gage d’une exigence scientifique et d’une réflexion approfondie sur les enjeux contemporains du droit. Le volume s’ouvre sur une préface remarquable de Fabrice Defferrard, maître de conférences HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, qui donne d’emblée une tonalité à la fois sensible et philosophique à l’ensemble. En s’appuyant sur la métaphore de l’enfant-robot David, protagoniste du film A.I. Intelligence artificielle de Steven Spielberg, inspiré de l’œuvre de Brian Aldiss, Defferrard propose une lecture profondément éthique de la protection de l’enfance. L’enfant artificiel, programmé pour aimer mais condamné à ne pas être aimé, incarne selon lui la vulnérabilité universelle de l’enfance et la responsabilité morale qu’ont les adultes de ne jamais laisser un enfant sans affection ni protection. Ce détour littéraire et cinématographique, d’une grande force symbolique, sert de miroir à notre société contemporaine et à ses défaillances, en soulignant la nécessité d’une vigilance constante face à la souffrance des enfants réels, trop souvent invisibles ou négligés.

Après cette ouverture empreinte d’humanité, l’ouvrage présente le rapport introductif de Clotilde Brunetti-Pons, qui expose les conclusions d’une recherche rigoureuse menée entre 2022 et 2024 dans le cadre du CEJESCO. Ce texte fondateur établit les grandes lignes du diagnostic posé sur la protection de l’enfance en France et dans plusieurs pays européens. L’autrice y met en évidence un système en crise, miné par une inflation législative rendant le droit illisible, un cloisonnement persistant entre les multiples institutions (étatiques, judiciaires, sociales et associatives), un manque de coordination et un déficit d’évaluation fiable des dispositifs existants. Elle souligne que cette inefficacité ne résulte pas seulement d’un manque de moyens, mais aussi d’une crise de sens, au cœur même des représentations de la protection de l’enfance.
Cette crise, selon Brunetti-Pons, tient à une tension profonde entre deux visions : celle de l’enfant comme sujet de droits, reconnu pour son autonomie et sa parole, et celle de l’enfant comme être vulnérable, nécessitant encadrement et sauvegarde. Comment concilier ces deux exigences sans sacrifier ni la liberté ni la sécurité de l’enfant ? C’est autour de ce dilemme que s’articule l’ensemble de la recherche, cherchant à définir ce qu’« efficacité » veut dire lorsqu’il s’agit non d’un système abstrait, mais de vies humaines en devenir. L’ouvrage se présente ainsi comme une réflexion à la fois juridique, politique et morale sur la responsabilité collective envers l’enfance, invitant à refonder les pratiques à la lumière d’une véritable culture de la protection et du respect.
Les auteurs de ce collectif, parmi lesquels Marie-Christine Le Boursicot, Geoffray Brunaux, Younes Bernand, Christian Flavigny, Jean-Michel Morin, Aline Cheynet de Beaupré, Blandine Mallevaey, ou encore Alain Sériaux, apportent chacun une pierre essentielle à l’édifice intellectuel que constitue cet ouvrage. Tous spécialistes reconnus dans leurs domaines, droit civil, droit pénal, sociologie, psychologie ou médecine, ils contribuent à une analyse transversale et comparée du droit de la protection de l’enfance. Le projet dépasse ainsi le simple cadre juridique pour embrasser l’ensemble des dimensions qui structurent la protection de l’enfant dans nos sociétés contemporaines.
Les contributions abordent des thématiques variées mais complémentaires. Certaines examinent les enjeux de gouvernance et d’organisation institutionnelle, en interrogeant la place de l’État, des départements, du juge des enfants et des structures associatives dans la mise en œuvre concrète des politiques publiques. D’autres explorent des problématiques spécifiques et particulièrement sensibles : la prostitution juvénile, analysée comme un défi majeur pour les professionnels de terrain (Younes Bernand) ; la protection face aux risques numériques (Geoffray Brunaux), question devenue centrale à l’ère des réseaux sociaux et de la cyberviolence ; la protection patrimoniale et successorale de l’enfant (Nathalie Baillon-Wirtz), qui révèle les failles de la pratique notariale ; ou encore le cas particulier de l’adoption des enfants en Polynésie française (Marie-Christine Le Boursicot et Myriam Pradet), illustrant la diversité des situations juridiques au sein même du territoire français.
La deuxième partie de l’ouvrage L’efficacité de la protection de l’enfance en France et à l’échelle européenne adopte une approche comparative à l’échelle européenne et internationale. Les auteurs y confrontent les modèles français à ceux d’autres pays, Allemagne, Italie, Espagne, Luxembourg, Royaume-Uni, analysant leurs fondements constitutionnels, leurs dispositifs d’aide sociale, leurs politiques d’accueil familial ou encore leurs réformes récentes en matière de justice des mineurs. Cette ouverture internationale, nourrie d’études de terrain et d’exemples concrets, permet de situer la France dans un paysage européen en mutation, où la recherche d’efficacité s’articule de plus en plus autour de la prévention, de la coordination et du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Enfin, l’ouvrage s’enrichit de contributions issues des sciences humaines et sociales. Le pédopsychiatre Christian Flavigny propose une réflexion psychologique sur la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, en la confrontant au regard du droit. Le sociologue Jean-Michel Morin analyse la protection de l’enfance comme un système social complexe, traversé par des effets institutionnels et contextuels. Le psychiatre Marc Windisch livre un témoignage clinique sur la prévention du suicide chez l’enfant, donnant une dimension humaine et concrète aux constats juridiques.
Cette diversité des perspectives illustre pleinement l’ambition de l’ouvrage : dépasser les cloisonnements disciplinaires pour repenser la protection de l’enfance dans toute sa complexité. En articulant les savoirs juridiques, psychologiques et sociologiques, les auteurs visent à construire une vision intégrée et cohérente des dispositifs de protection, fondée sur une évaluation empirique des pratiques et sur une culture du résultat. Ce dialogue interdisciplinaire, rare dans ce domaine, fait de l’ouvrage une référence incontournable pour tous ceux qui œuvrent à la défense des droits et du bien-être des enfants.
L’apport de cet ouvrage se révèle particulièrement riche et s’articule autour de deux axes majeurs, qui en font une contribution de premier plan à la pensée contemporaine sur la protection de l’enfance. D’une part, il propose un diagnostic lucide et sans complaisance d’un système français fragmenté, où la multiplication des réformes successives, souvent élaborées dans l’urgence politique ou émotionnelle, tend à masquer l’inefficacité concrète des dispositifs de terrain. En croisant les analyses juridiques, les constats institutionnels et les témoignages de praticiens, le collectif met en évidence les failles structurelles du dispositif : empilement normatif, manque de coordination entre les services de l’État et les départements, hétérogénéité des pratiques, absence d’outils d’évaluation partagés, et déficience chronique en matière de suivi statistique. L’ensemble aboutit à une même conclusion : la protection de l’enfance souffre moins d’un vide juridique que d’un excès de règles inopérantes, mal articulées et parfois contradictoires, qui empêchent toute cohérence d’action au bénéfice réel des enfants.
D’autre part, le livre ne se contente pas de dresser un état des lieux critique : il avance une véritable méthodologie d’évaluation et d’action, fruit d’une réflexion collective approfondie. Cette méthode repose sur la définition d’indicateurs d’efficacité clairs, sur la mise en place d’outils de mesure partagés entre institutions, et sur la formulation de cent recommandations opérationnelles. Celles-ci visent à repenser la gouvernance nationale et locale, à renforcer la formation des acteurs (magistrats, travailleurs sociaux, éducateurs, médecins, enseignants), à harmoniser le vocabulaire professionnel pour faciliter la communication entre services, à améliorer les contrôles et les évaluations de terrain, et à encourager une coopération accrue entre les États européens. Ces propositions, pragmatiques et graduées, traduisent une volonté de refonder la politique de protection de l’enfance sur une base empirique, rationnelle et concertée, plutôt que sur des logiques purement institutionnelles.
Par son ancrage comparatif et pluridisciplinaire, l’ouvrage dépasse les frontières du droit pour ouvrir un espace de dialogue entre juristes, psychologues, sociologues et décideurs publics. Cette approche intégrée permet de replacer la question de l’efficacité non seulement dans une perspective technique, mais aussi éthique et humaine : comment mesurer la réussite d’un système si ce n’est à travers le bien-être des enfants qu’il prétend protéger ? À ce titre, l’ouvrage renouvelle en profondeur la réflexion sur la protection de l’enfance en France et en Europe, en montrant que le droit n’est efficace que s’il est vivant, cohérent et incarné dans les pratiques. Par sa rigueur scientifique, la richesse de ses analyses et la portée de ses propositions, il s’impose comme un outil de référence pour les chercheurs, les professionnels et les décideurs publics désireux de repenser la place de l’enfant au cœur des politiques sociales et juridiques contemporaines.
L’impact de cet ouvrage dépasse déjà le simple cercle académique pour conférer une visibilité urgente et nécessaire à un débat national et européen sur la responsabilité publique effective envers les enfants. Grâce à sa démarche rigoureuse et à la pertinence de ses conclusions, il ne fait pas qu’alimenter les discussions : il les structure en se constituant en une référence tangible pour les juristes, les décideurs et les professionnels du social. Il devient un point de convergence pour les réflexions institutionnelles, notamment au Conseil supérieur du notariat sur les enjeux de protection patrimoniale du mineur, et auprès des instances européennes où son approche comparée sert de fondement à une harmonisation des pratiques et des standards d’efficacité.
Le cœur de sa force réside dans cette confrontation lucide du droit à sa mise en œuvre concrète. En mettant en lumière l’écart entre la profusion normative et la défaillance des dispositifs de terrain, l’ouvrage dénonce la tendance à réduire l’enfant à une simple abstraction juridique. Il montre qu’un système inefficace, miné par le cloisonnement et le manque de coordination, finit par ignorer l’individu qu’il prétend protéger. Par son plaidoyer pour une culture du résultat basée sur l’évaluation empirique, le collectif opère un basculement essentiel : il replace l’enfant au centre du dispositif non pas comme une catégorie de droit, mais comme un être humain à protéger dans sa dignité et son développement. Il nous impose une éthique de l’efficacité, où la réussite du système se mesure exclusivement à la sécurité, à l’épanouissement et au bien-être réel des enfants.
Il est, d’une part, le constat sans concession d’un système insuffisant. Ce constat est bâti sur une analyse critique rigoureuse qui expose les faiblesses structurelles françaises : un système miné par une inflation législative illisible, un cloisonnement institutionnel nuisible entre l’État et les départements, et une déficience chronique dans l’évaluation des dispositifs existants. Les auteurs démontrent que l’inefficacité ne résulte pas d’un manque de moyens seul, mais d’une véritable crise de cohérence et d’une perte de sens, où l’accumulation de réformes successives, souvent déconnectées du terrain, a empêché l’émergence d’une véritable culture de la protection.
D’autre part, ce livre est un manifeste exigeant pour une protection renouvelée, véritablement cohérente et centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne s’arrête pas au diagnostic, mais propose une véritable feuille de route indispensable : il avance une méthodologie d’évaluation claire et formule les cent recommandations opérationnelles (comme mentionné précédemment) visant à repenser la gouvernance, à harmoniser les pratiques professionnelles et à renforcer la coopération européenne. L’appel est lancé pour une refondation basée non plus sur l’urgence politique, mais sur une rationalité empirique et un dialogue constant entre les disciplines (droit, psychologie, sociologie). Ce manifeste est éthique, car il replace l’efficacité au service de l’humain, exigeant que l’enfant soit considéré dans sa dignité et son développement plutôt que comme une simple catégorie juridique.
Par cette approche critique, documentée et transversale, le livre s’impose définitivement comme une contribution majeure à la pensée contemporaine du droit de l’enfance et à la reconstruction d’un véritable pacte de protection collective. Il force les acteurs publics à confronter l’idéal de la loi à la réalité du terrain, ouvrant la voie à des réformes pérennes et significativement plus efficaces.
Brahim Saci
L’efficacité de la protection de l’enfance en France et à l’échelle européenne, éditions Mare & Martin, 2025.