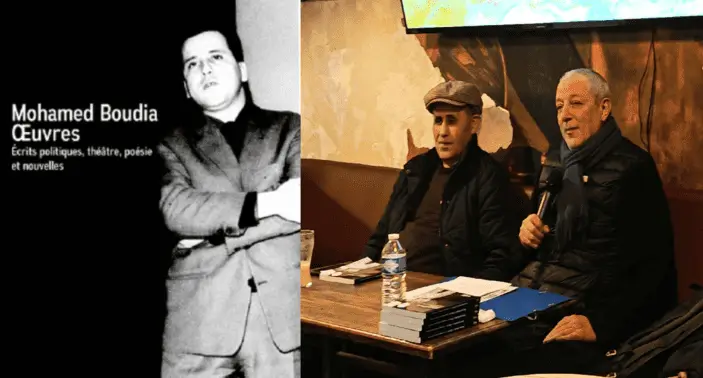Face aux discours anxieux sur le prétendu appauvrissement lié au métissage culturel, Didier Aubourd rappelle une évidence historique : les civilisations qui se rencontrent ne se diluent pas, elles s’élèvent. De la confluence sumérienne-akkadienne aux passeurs arabes de la philosophie grecque, les plus grandes avancées humaines sont nées de ces alliances. Chronique.
Un post lu sur LinkedIn m’a fait bondir. L’auteur y défendait l’idée que le métissage culturel conduit inévitablement à l’appauvrissement, à l’uniformité, à la perte de toute grandeur. Pour illustrer sa thèse, il utilisait une métaphore redoutable : celle du vin qu’on noie dans l’eau et qui perd son goût.
L’image est séduisante. Elle a la force des métaphores simples : le vin qu’on dilue, les couleurs qui virent au gris, la grandeur qui s’efface. Qui voudrait d’un monde sans relief ?
Mais cette métaphore suppose une chose : que les cultures soient des liquides inertes, des substances fixes qu’on mélange passivement jusqu’à les rendre insipides. Or l’histoire montre exactement l’inverse. Les cultures sont des organismes vivants, des processus dynamiques, des acteurs qui choisissent, filtrent, transforment.
J’écris ces lignes depuis la Côte d’Azur, cette bande de terre où se sont croisés Ligures, Grecs, Romains, Sarrasins, Italiens, et tant d’autres. Si la métaphore du vin dilué était juste, nous devrions vivre dans un brouillard culturel indistinct. Or nous n’y vivons pas.
Alors j’ai voulu confronter cette thèse à ce que je connais le mieux : l’histoire des civilisations mésopotamiennes, ces quatre millénaires d’échanges, de confluences et de métamorphoses qui ont précédé la Bible et la Grèce. Et ce que j’y ai trouvé ne ressemble en rien à du vin noyé dans l’eau.
Les cultures ne se dissolvent pas, elles choisissent
Premier constat, peut-être le plus important : il n’existe pas de remplacement culturel sans raison. Les peuples ne renoncent pas à leur langue, à leurs rites, à leurs récits par faiblesse ou par distraction. Ils intègrent ce qui répond à un besoin, ce qui ouvre des possibilités nouvelles, ce qui leur manquait.
L’exemple le plus éloquent nous vient de Mésopotamie, il y a plus de quatre mille ans.
Vers 2300 avant J.-C., les Akkadiens, un peuple sémitique venu du nord, s’imposent progressivement dans le sud de l’Irak actuel, où fleurit depuis des siècles la civilisation sumérienne. Les Sumériens ont inventé l’écriture, développé l’astronomie, codifié le droit, bâti les premières cités-États. Les Akkadiens, eux, ne possèdent pas de système d’écriture propre.
Que font-ils ? Ils adoptent le cunéiforme sumérien. C’est une appropriation créatrice. Comme le notent les spécialistes : « À partir de la fin du IIIe millénaire, les Akkadiens empruntent le système d’écriture des Sumériens et imposent leur langue ; mais le sumérien continue d’exister comme langue savante, à la manière du latin en Europe à partir du Moyen Âge. »
Les Akkadiens n’ont rien perdu. Ils ont transcrit leur langue sémitique, radicalement différente du sumérien (qui était un isolat linguistique), avec un outil qu’ils ont adapté à leurs besoins. Le sumérien, loin de disparaître, devient une langue de prestige, de liturgie, de savoir. Les scribes akkadiens recopient, commentent, traduisent les textes sumériens pendant des siècles. Ils créent des dictionnaires bilingues, véritables ponts entre deux mondes.
Un enrichissement mutuel où chaque partie conserve son identité tout en s’ouvrant à l’autre. Et de cette confluence naît Babylone.
Le laboratoire mésopotamien
Car Babylone, loin d’être le « gris uniforme » annoncé par les prophètes du déclin, devient l’un des foyers culturels les plus éblouissants de l’Antiquité.
Mathématiques : les Sumériens inventent le système sexagésimal, que les Babyloniens adoptent, perfectionnent et systématisent, nous léguant nos 60 minutes, nos 360 degrés, notre découpage du cercle. Astronomie : ils cartographient le ciel avec une précision qui ne sera égalée qu’à la Renaissance, identifient les planètes, prédisent les éclipses. Droit : le Code de Hammurabi, rédigé vers 1750 avant J.-C., reste l’un des plus anciens corpus juridiques connus, 282 articles gravés dans la pierre, qui influenceront le droit hébraïque et, à travers lui, toute la tradition juridique occidentale. Médecine : les traités diagnostiques babyloniens témoignent d’une observation clinique remarquable. Littérature : c’est à Babylone que prend forme la version « canonique » de l’Épopée de Gilgamesh, ce que Jean Bottéro considérait comme la première grande épopée de l’humanité.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans la confluence sumério-akkadienne. Les Babyloniens ne sont ni sumériens ni akkadiens : ils sont les héritiers des deux, et cette double filiation les propulse vers des sommets que ni l’une ni l’autre culture n’aurait atteints seule.
Gilgamesh, justement. Cette œuvre est le meilleur démenti possible à la thèse de l’appauvrissement par le mélange.
Les premiers récits sur ce roi légendaire d’Uruk apparaissent en sumérien, à la fin du IIIe millénaire. Ce sont des poèmes indépendants, des fragments épars. Puis vient une première synthèse en akkadien ancien, vers 1800-1600 avant J.-C., intitulée Shûtur eli sharrî (« Surpassant tous les rois »). Enfin, entre 1300 et 1000 avant J.-C., un lettré babylonien, peut-être Sîn-lēqi-unninni, compose la version « standard », Sha naqba īmuru (« Celui qui a tout vu »), celle que nous lisons aujourd’hui.
Chaque strate ajoute, transforme, approfondit. Le texte voyage, se traduit en hittite et en hourrite, circule de la Méditerranée à l’Iran. Comme l’écrit le grand spécialiste Andrew George, c’est « an invaluable guide to all the different strands which came together to produce the work we now call Gilgamesh », un guide précieux vers tous les fils différents qui se sont tissés pour produire l’œuvre que nous appelons Gilgamesh.
Un palimpseste vivant. Un grand cru qui se bonifie avec le temps, enrichi par chaque terroir qu’il traverse.
Les passeurs arabes
Faisons un saut de deux millénaires. Nous sommes au XIIe siècle. L’Europe latine sort à peine de ce qu’on appelait autrefois les « âges sombres ». Elle a presque tout oublié d’Aristote, de Platon, d’Euclide, de Galien. Les grandes bibliothèques antiques ont brûlé, les chaînes de transmission se sont rompues, le grec est devenu une langue presque inconnue en Occident.
Presque tout oublié. Car ces textes n’ont pas disparu. Ils ont voyagé.
Depuis le VIIIe siècle, les savants de Bagdad, dans la fameuse Maison de la Sagesse (Bayt al-Hikma), traduisent systématiquement le corpus grec en arabe. Le calife al-Ma’mun envoie des émissaires jusqu’à Byzance pour rapporter des manuscrits. Des équipes de traducteurs, souvent des chrétiens syriaques comme Hunayn ibn Ishaq, travaillent pendant des décennies à rendre accessibles Aristote, Platon, Galien, Hippocrate, Euclide, Ptolémée.
Puis viennent les commentateurs, ces esprits qui ne se contentent pas de transmettre mais qui interrogent, critiquent, prolongent : al-Farabi, qu’on surnomme « le second maître après Aristote » ; Avicenne (Ibn Sina) et son encyclopédie philosophique, le Livre de la guérison ; al-Khwarizmi, dont le nom a donné le mot « algorithme » ; et surtout Averroès (Ibn Rushd), le Commentateur par excellence, celui dont Thomas d’Aquin dira qu’il a « perfectionné » la philosophie d’Aristote.
Au XIIe siècle, ces textes arrivent en Europe par Tolède, Palerme, la Sicile, ces carrefours où se croisent chrétiens, musulmans et juifs. Des traducteurs comme Gérard de Crémone transposent en latin ce qui avait été traduit du grec en arabe, parfois en passant par le syriaque ou l’hébreu.
L’historien de la philosophie Alain de Libera, professeur au Collège de France, l’affirme sans ambiguïté : « Que les « Arabes » aient joué un rôle déterminant dans la formation de l’identité culturelle de l’Europe [est une chose] qu’il n’est pas possible de discuter, à moins de nier l’évidence. »
Et il précise : « Ibn Rushd (Averroès) mourra en 1198, laissant derrière lui une œuvre qui, durant plusieurs siècles, restera le principal ferment de la réflexion philosophique occidentale. »
Sans Bagdad et Cordoue, pas de Thomas d’Aquin. Pas de scolastique. Pas de Renaissance au sens où nous l’entendons. L’Europe n’a pas reçu Aristote directement des Grecs : elle l’a reçu des Arabes, qui l’avaient eux-mêmes traduit, commenté, enrichi.
Le « gris uniforme » promis par les déclinistes ? C’est au contraire une explosion de couleurs. La rencontre de la philosophie grecque, de la théologie chrétienne et de la pensée arabe produit l’une des périodes les plus fécondes de l’histoire intellectuelle occidentale.
La coalition des cultures
Ces exemples ne sont pas des exceptions. Ils illustrent une loi que l’anthropologue Claude Lévi-Strauss a formulée avec une clarté définitive dans Race et Histoire, ce texte fondateur écrit pour l’UNESCO en 1952 :
« Aucune culture n’est seule ; elle est toujours donnée en coalition avec d’autres cultures, et c’est cela qui lui permet d’édifier des séries cumulatives. »
Coalition. Le mot est capital. Il ne s’agit pas de fusion passive, de mélange indistinct. Il s’agit d’alliance, de collaboration, de jeu combiné. Lévi-Strauss utilise la métaphore du jeu de dés : un joueur isolé a peu de chances d’obtenir une combinaison favorable ; mais si plusieurs joueurs mettent leurs résultats en commun, les probabilités changent radicalement.
« Tout progrès culturel est fonction d’une coalition entre les cultures », conclut-il.
La Renaissance européenne en est l’exemple parfait : elle naît de la rencontre entre l’héritage gréco-romain (redécouvert via les Arabes), les apports techniques venus de Chine (la boussole, l’imprimerie, la poudre), les savoirs mathématiques indiens (le zéro, le système décimal), et les traditions locales européennes. Aucune de ces cultures n’a été « diluée ». Chacune a apporté ses dés à la table commune.
Ce qui tue vraiment les cultures
Alors, si l’échange n’est pas le danger, qu’est-ce qui menace réellement les cultures ?
La réponse est simple, et elle est terrible : ce qui tue les cultures, ce n’est pas la rencontre, c’est l’écrasement.
L’interdiction des langues. La destruction des manuscrits. La conversion forcée. L’arrachement des enfants à leurs familles. L’effacement systématique des mémoires. La négation de l’autre comme sujet, comme être humain digne de respect.
L’histoire en offre des exemples tragiques. Les Taïnos des Caraïbes, premiers Amérindiens rencontrés par Colomb, ont pratiquement disparu en quelques décennies : exterminés. Les politiques d’assimilation forcée des peuples autochtones en Australie, au Canada, aux États-Unis (enfants arrachés à leurs familles, langues interdites, cultures criminalisées) relèvent de la même logique de destruction. Plus près de nous, les Kurdes de Turquie ont vu leur langue interdite pendant des décennies : jusqu’en 1991, l’usage du kurde était prohibé y compris en privé, et il a fallu attendre 2002 pour que l’enseignement privé en kurde soit autorisé.
Tzvetan Todorov, dans La Conquête de l’Amérique (1982), a documenté avec une précision glaçante ce que fut la destruction des civilisations amérindiennes :
« En 1500, la population du globe doit être de l’ordre de 400 millions, dont 80 habitent les Amériques. Au milieu du seizième siècle, de ces 80 millions, il en reste 10. »
Au Mexique seul : 25 millions d’habitants à la veille de la conquête, 1 million en 1600. Une annihilation, par les armes, par les maladies, par l’esclavage, par la négation de l’autre comme sujet humain.
Et Todorov tire de cette histoire une leçon morale essentielle : « Vivre la différence dans l’égalité : la chose est plus facile à dire qu’à faire. »
Car la distinction cruciale est là. L’échange suppose deux parties vivantes, libres de choisir ce qu’elles intègrent et ce qu’elles refusent. La domination nie cette liberté. Elle ne mélange pas : elle écrase. Elle ne colore pas : elle efface.
Les Aztèques ont été décimés, leurs temples rasés, leurs codex brûlés, leurs prêtres massacrés. Ce qui en reste, et il en reste beaucoup dans la culture mexicaine contemporaine, a survécu malgré la destruction.
Les cépages nouveaux
Je reviens à la métaphore initiale, celle du vin noyé dans l’eau.
Elle est fausse, et elle est fausse pour une raison précise : elle suppose que les cultures sont des produits finis, des essences immuables qu’on ne peut que dégrader en les mélangeant. Des bouteilles scellées qu’il suffirait d’ouvrir pour les corrompre.
Mais les cultures ne sont pas du vin en bouteille. Elles sont des vignes vivantes. Elles poussent, s’adaptent, se greffent, résistent aux parasites, développent de nouvelles saveurs selon les terroirs où on les plante.
Et que se passe-t-il quand on croise des cépages ? On n’obtient pas de l’eau grise. On obtient des variétés nouvelles, adaptées à de nouveaux terroirs, capables de résister à de nouvelles maladies, porteuses de saveurs inédites.
Le Cabernet-Sauvignon, ce cépage roi du Bordelais, est né du croisement entre le Cabernet Franc et le Sauvignon Blanc. Le Pinotage sud-africain vient du Pinot Noir et du Cinsault. Le Müller-Thurgau allemand descend du Riesling et du Madeleine Royale. La viticulture mondiale repose sur ces hybridations successives, ces greffes, ces adaptations. Sans elles, le phylloxéra aurait anéanti les vignobles européens au XIXe siècle.
Les cultures fonctionnent de même.
Le français que j’écris est né du latin vulgaire « noyé » dans les substrats gaulois et ligures, puis enrichi par le francique des envahisseurs germaniques, puis façonné par des siècles d’emprunts à l’italien (banque, balcon, opéra), à l’arabe (algèbre, algorithme, azur), à l’anglais (plus récemment : budget, parking, marketing). Est-ce du « gris » ? Est-ce un appauvrissement ? Ou est-ce l’une des langues les plus riches, les plus nuancées, les plus littéraires du monde ?
La grandeur n’a jamais été fille de l’isolement. Elle naît du dialogue, parfois tendu, parfois conflictuel, mais toujours fécond, entre des traditions qui se confrontent et se transforment mutuellement.
Les Assyriens, héritiers de Babylone, ont développé leur propre esthétique, leur propre rapport au pouvoir, leur propre brutalité militaire. Ils ont transformé ce qu’ils avaient reçu. Les Perses achéménides, en conquérant la Mésopotamie, ont à leur tour intégré et transmis cet héritage. Puis vinrent les Grecs d’Alexandre, puis les Parthes, puis les Sassanides. Chaque vague a déposé ses alluvions, et c’est de cette sédimentation qu’est née la civilisation que nous appelons aujourd’hui, un peu vite, « occidentale ».
Conclusion
Craindre la rencontre, c’est méconnaître la vitalité créatrice des civilisations.
C’est aussi, peut-être, confondre deux choses très différentes : l’échange libre entre cultures vivantes, et l’uniformisation imposée par la domination économique ou politique.
Car il y a bien une menace réelle, aujourd’hui, sur la diversité culturelle. Mais elle ne vient pas du métissage. Elle vient de la standardisation marchande, de l’hégémonie de quelques langues véhiculaires, de la disparition des savoirs locaux au profit de modèles uniformes. Elle vient de la logique du profit qui réduit les cultures à des « contenus » et les traditions à des « marques ». Elle vient, en somme, de l’asymétrie des pouvoirs.
Partager une recette avec son voisin n’a rien à voir avec voir sa cuisine remplacée par un fast-food. Apprendre une langue étrangère par curiosité n’a rien à voir avec voir la sienne interdite à l’école. Emprunter une technique à une autre culture n’a rien à voir avec se voir imposer un modèle de développement unique.
Défendre la diversité culturelle, c’est créer les conditions d’un échange équitable, où chaque culture peut apporter ses dés à la table commune sans être écrasée par les autres. C’est reconnaître que la richesse du monde tient à sa pluralité, et que cette pluralité n’est pas un obstacle au dialogue, elle en est la condition.
L’histoire ne nous montre pas du vin dilué. Elle nous montre des cépages nouveaux.
Et c’est dans ces cépages nouveaux, nés de croisements improbables et de terroirs inattendus, que se trouve la grandeur. Celle d’un avenir à inventer.
Didier Aubourd