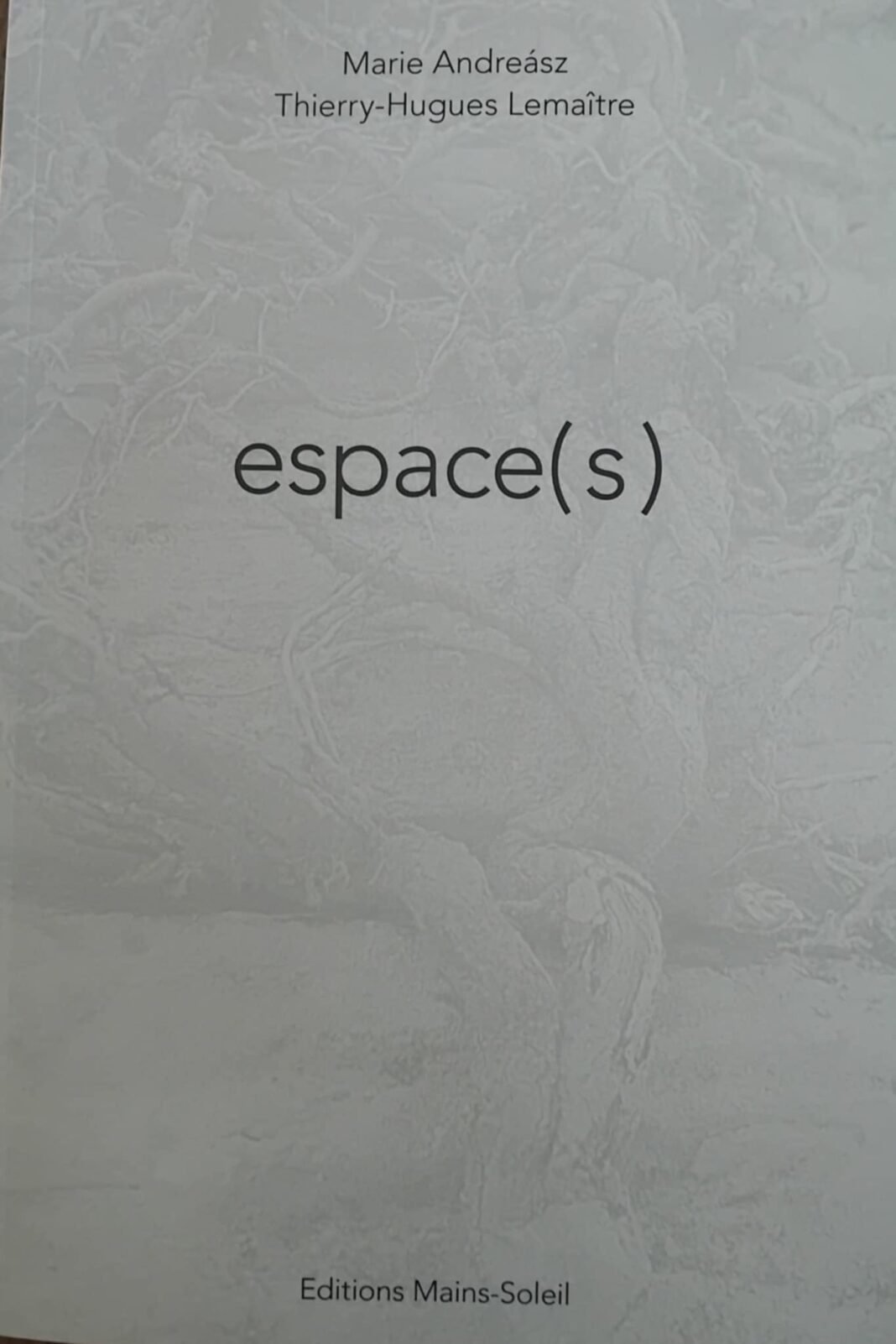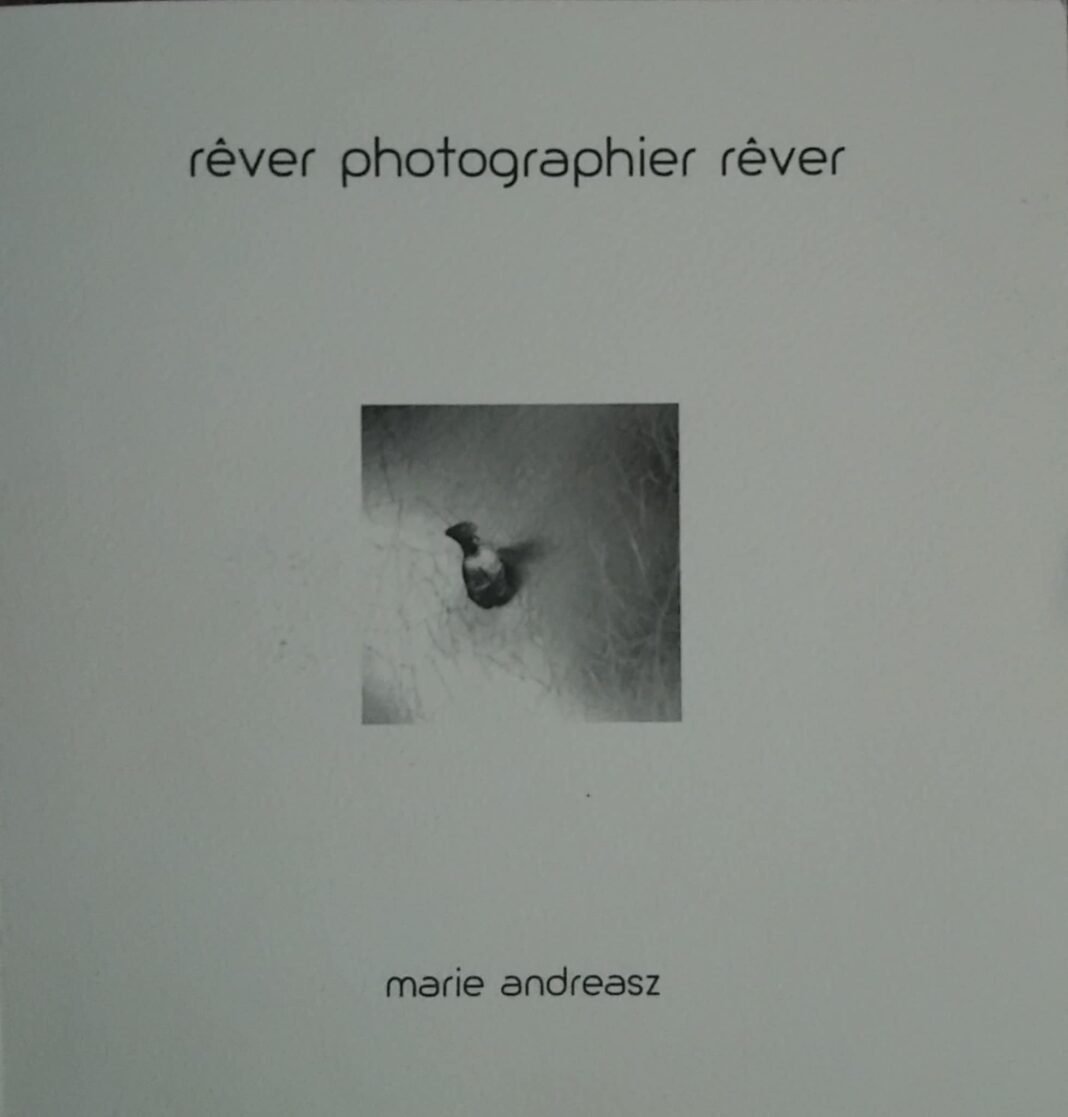Azal Belkadi est l’un de ces rares artistes dont le parcours, la démarche et l’œuvre tissent un pont entre plusieurs disciplines avec une cohérence troublante.
Peintre, chanteur lyrique, restaurateur d’œuvres d’art : tout chez lui Azal Belkadi à une même urgence intérieure, celle de préserver, transmettre et sublimer la mémoire amazighe. Mais ce qui frappe immédiatement chez lui, au-delà de la richesse de ses talents, c’est la force unifiée de son regard. Il observe le monde avec une précision de sculpteur, une tendresse de poète et une intensité de tragédien. Chaque toile, chaque note chantée, chaque bijou ciselé devient le support d’un même élan : sauver de l’oubli ce qui constitue l’âme de son peuple.
Né au cœur de la Kabylie, il s’imprègne dès son enfance d’une culture ancestrale transmise oralement, souvent par les femmes. Ce n’est pas un hasard si la femme devient, dans sa peinture, le pivot central : elle est mémoire, résistante, messagère, mais aussi figure de beauté sacrée. Sa formation aux Beaux-Arts d’Azazga puis d’Alger, enrichie d’une spécialisation en restauration du patrimoine pictural via l’UNESCO, lui donne une assise technique solide, mais c’est son intériorité qui fait vibrer ses œuvres.
Les œuvres picturales d’Azal Belkadi s’imposent par la force tranquille qui en émane, cette manière presque silencieuse mais impérieuse de capturer l’essence de l’âme féminine, ancrée dans la mémoire millénaire des peuples berbères. Il ne s’agit pas seulement de portraits : ce sont des témoignages picturaux, des fragments d’histoire réanimés par la couleur, la lumière, et le regard. L’artiste déploie sur la toile une galerie de femmes qui, loin d’être figées dans un passé folklorique, vibrent d’une présence souveraine. Chacune incarne un pan de culture, une résistance, une identité farouche. Ces femmes ne sont pas décoratives, elles sont debout — dignes, solides, traversées d’émotions contenues et pourtant si puissantes.
| À LIRE AUSSI |
| Amour Abdenour embrase le Dôme de Paris |
Belkadi travaille à la frontière du réalisme et de l’intemporel. Son pinceau révèle une parfaite maîtrise technique : la précision du trait, la richesse des textures, le rendu soyeux des étoffes et des bijoux, tout concourt à rendre chaque détail vivant, presque palpable. Mais ce n’est pas dans la technique seule que réside sa grandeur. C’est dans la profondeur du regard qu’il prête à ses sujets. Ces yeux, souvent sombres, toujours pénétrants, racontent bien plus qu’un visage : ils racontent une langue, une terre, une transmission, un effacement évité de justesse. On lit dans ces regards la force muette des femmes amazighes, porteuses d’un savoir non écrit, de gestes anciens, de chants de résistance murmurés d’une génération à l’autre.
Ses portraits de femmes amazighes, stylisés ou réalistes, témoignent d’une acuité ethnographique rare, mais aussi d’une esthétique profonde : coiffes brodées, parures d’argent et de corail, tatouages symboliques, costumes faits main, chaque détail raconte un monde. Ses pinceaux ne décorent pas : ils invoquent. Ils rappellent, au-delà du visible, les récits oubliés, les vies silencieuses, les chants étouffés. Chaque parure, chaque tatouage, chaque broderie n’est pas un simple ornement : c’est un symbole. Un code. Un cri. L’artiste ressuscite des éléments que la modernité tente d’effacer, les réinscrit dans le présent avec une solennité qui force le respect.
Les tatouages bleutés sur les visages, les fibules, les lourdes parures en argent ornées de pierres rouges — tout cela compose une langue visuelle qu’il faut savoir lire. Ces signes évoquent la féminité sacrée, la protection, la fertilité, l’ancrage dans un cosmos spirituel oublié ou délaissé. En redonnant à ces codes leur éclat, Azal Belkadi opère un travail de mémoire à la fois artistique et anthropologique. Il peint pour se souvenir, et pour faire souvenir.
Parallèlement à cette œuvre picturale puissante, Azal Belkadi développe une carrière lyrique atypique. Sa voix de ténor, ample et poignante, restitue les mélodies anciennes du patrimoine kabyle dans une forme contemporaine. Il ne se contente pas d’interpréter : il recrée, transcrit, harmonise. Le chant acewwiq, par exemple — forme poétique improvisée et chantée par les femmes kabyles — devient dans sa bouche un chant sacré, souvent interprété sur scène avec un accompagnement sobre, qui en décuple la puissance émotionnelle.
Son travail lyrique ne cherche pas à moderniser pour séduire, mais à sublimer pour transmettre. Il restitue des chants que peu osent encore chanter, parfois même oubliés des anciens. Il s’investit activement dans l’accompagnement et le renforcement de chorales féminines, insufflant une nouvelle confiance aux voix encore timides, tout en réintroduisant auprès des jeunes générations les tonalités ancestrales et les paroles oubliées, alliant avec subtilité une rigueur technique à une profonde sensibilité émotionnelle. Parmi ces engagements, résonnent particulièrement la chorale Thiliwa et celle dédiée à Taos Amrouche, figure tutélaire à laquelle il revendique un héritage culturel et artistique avec une conviction assumée. Là encore, ce sont les femmes qui sont au cœur de sa transmission, comme s’il leur rendait à chaque œuvre, à chaque note, ce qu’il avait reçu d’elles.
Loin d’idéaliser, il immortalise. Il refuse les clichés. Il offre à ces femmes une place que l’histoire officielle leur a trop souvent refusée. Et même lorsqu’il représente une enfant, c’est toujours avec cette même gravité tendre, comme pour souligner que la transmission est déjà en marche, que la filiation ne connaît ni vide ni oubli. Son art se fait ainsi matrice : entre les générations, entre les siècles, entre les blessures du passé et la fierté retrouvée.
L’impact de son œuvre est immense, bien que discret, presque souterrain. Azal Belkadi ne cherche pas la lumière médiatique : il cherche la résonance. Il ne s’adresse pas à une mode ou à un marché, mais à une mémoire. Il touche au sacré, dans le sens le plus noble du terme : celui qui relie les vivants à leurs racines. Il rappelle, avec exigence, que l’art n’est pas seulement une affaire de forme, mais une affaire de sens, de mémoire et d’âme.
Il faut également souligner son rôle dans la transmission intergénérationnelle. Par ses ateliers, ses chorales, ses spectacles, ses œuvres visuelles, il réconcilie le passé avec le présent. Il crée des ponts, initie des jeunes à l’art comme moyen d’expression mais aussi de résistance culturelle. À l’heure où de nombreuses identités sont menacées par l’uniformisation globale, Azal Belkadi oppose la beauté d’une singularité farouchement préservée.
Azal Belkadi ne se contente pas de produire de la beauté ; il produit du sens. Son apport est majeur car il conjugue l’esthétique à l’éthique, la mémoire à l’émotion. Il œuvre là où tant se taisent, en donnant à voir ce qui mérite d’être regardé avec lenteur, attention et gratitude. Dans un monde qui va vite, son travail nous invite à l’arrêt, à la contemplation et à l’interrogation : d’où venons-nous ? Qui sommes-nous quand nos racines sont pleines de chants oubliés ? En cela, ses portraits ne sont pas seulement des femmes : ce sont des nations silencieuses qui reprennent parole.
Azal Belkadi est plus qu’un artiste : il est un passeur. Il fait de la Kabylie un creuset d’universalité. Par son chant, il ravive l’émotion première de la poésie orale. Par sa peinture, il fixe ce qui est fugace : une attitude, un regard, un bijou transmis de mère en fille. Et dans les deux cas, il agit comme un veilleur. Dans un monde qui oublie vite, il fait œuvre de mémoire. Dans un monde qui consomme, il célèbre. Dans un monde qui simplifie, il complexifie, nuance, raconte.
Avec une pudeur rare et une force intérieure exceptionnelle, il rappelle que l’art est un langage de vérité, et que toute culture menacée contient en elle une lumière qu’il faut préserver, coûte que coûte. Son pinceau est une mémoire debout. Une flamme. Un héritage vivant.
Brahim Saci