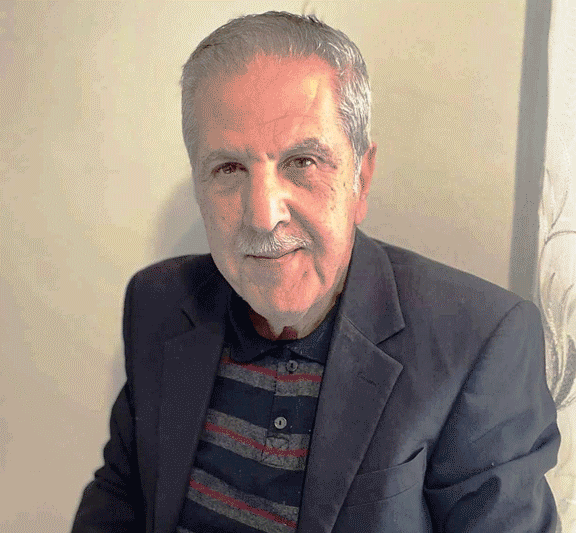Saïd Saad, écrivain et journaliste algérien, s’impose comme une voix singulière dans le paysage littéraire et intellectuel algérien.
Après plus de trois décennies passées au sein de l’Agence algérienne de Presse (APS), notamment comme correspondant à Londres, Saïd Saad a choisi la littérature comme nouvel espace d’expression, un lieu où la mémoire, l’histoire et la subjectivité peuvent se rejoindre, se questionner et se transmettre.
Ce basculement du journalisme vers la fiction ou le récit historique n’est pas une rupture, mais plutôt une continuité : celle d’un engagement envers la vérité, non pas seulement factuelle, mais humaine, incarnée.
Dès son premier roman, Parfums d’une femme perdue (2010), l’écrivain Saïd Saad explore des dimensions intimes, mêlant quête identitaire et sensibilité sociale, dans une langue dépouillée, accessible, mais toujours soucieuse du détail. Ce style, à la croisée de la chronique et de la prose littéraire, deviendra sa marque de fabrique. Mais c’est avec Les tranchées de l’imposture, publié en 2018 chez Dar El Othmania, que l’écrivain s’inscrit pleinement dans une démarche mémorielle. Ce livre, inspiré par l’histoire de son père, le sergent-chef Saad Ali (1920–2016) — un ancien tirailleur algérien ayant combattu sous l’uniforme français durant la Seconde Guerre mondiale — est bien plus qu’un hommage filial : c’est un cri contre l’oubli, une tentative de réintégrer ces soldats coloniaux dans la trame historique algérienne, souvent peu ou mal racontée. Loin du pathos, l’ouvrage se veut à la fois documenté, incarné et profondément humain. Il révèle l’envers de la guerre, les zones grises de la loyauté, les douleurs muettes des oubliés de l’Histoire.
L’auteur poursuit cette démarche d’exploration des fractures invisibles de l’histoire contemporaine dans Les rescapés de Pula, roman paru en 2023. Cette fois, il déplace son regard vers les drames actuels : l’exil, les migrations clandestines, la Méditerranée comme ligne de fracture entre espoir et naufrage. À travers le parcours d’un jeune Algérien parti à la recherche d’un avenir en Europe, c’est toute la complexité du déracinement moderne qu’il met en scène. Sans misérabilisme, avec une grande pudeur, Saïd Saad interroge l’illusion d’un ailleurs salvateur, mais aussi la violence des frontières, visibles et invisibles. Son écriture, nourrie par une longue pratique de terrain, conserve cette sobriété qui laisse toute la place à la parole des invisibles.
Faire de la biographie un outil de transmission
En 2025, il ajoute une nouvelle pierre à son édifice avec la publication de Amar Ezzahi, une légende de renouveau de la chanson chaâbi. Ce livre, plus proche du portrait que de la biographie classique, plonge dans l’univers du grand maître du chaâbi, en explorant la portée culturelle, poétique et populaire de son œuvre. Saïd Saad y révèle non seulement l’homme pudique et insaisissable qu’était Ezzahi, mais aussi l’impact profond de sa musique dans la société algérienne, notamment dans les quartiers populaires où ses chansons résonnent comme des fragments de vie partagée. Loin d’enfermer l’artiste dans une icône figée, l’auteur met en lumière ses contradictions, son refus du star-système, sa quête d’authenticité. Ce travail, nourri de témoignages, d’archives et d’émotion, s’inscrit dans une démarche patrimoniale : faire de la biographie un outil de transmission, une passerelle entre générations.
L’apport de Saïd Saad à la littérature algérienne contemporaine est multiple. Il restitue des voix étouffées, redonne de l’épaisseur humaine à des figures marginalisées ou oubliées, et propose une écriture sobre, au service de la mémoire collective. Son regard de journaliste ne s’efface jamais complètement : il nourrit la rigueur documentaire de ses récits, mais il se mue ici en regard d’écrivain, capable de saisir les silences, les failles, les émotions non dites. Dans un pays où la mémoire est souvent disputée, morcelée, voire instrumentalisée, son œuvre vient combler des vides, poser des jalons, ouvrir des chemins de réflexion.
Saïd Saad occupe une place discrète mais essentielle dans la scène littéraire algérienne. Il n’est pas de ceux qui cherchent la lumière ou les récompenses, mais plutôt de ceux qui creusent patiemment les silences, explorent les marges, et redonnent voix à ceux qui n’ont pas toujours eu la possibilité de raconter leur histoire. Il n’écrit pas pour séduire ou pour orner, mais pour dire ce qui a été tu, ce qui a été effacé, disqualifié, ignoré. Sa prose, à la fois modeste et tendue, évite les effets faciles. Elle privilégie l’écoute, l’humain, la vérité vécue — une vérité parfois douloureuse, jamais grandiloquente, mais toujours incarnée.
Son travail relève d’un véritable acte de mémoire, au sens le plus noble du terme : une mémoire qui ne se contente pas d’archiver, mais qui cherche à transmettre, à réveiller, à relier. Il ne s’agit pas, chez lui, d’un regard nostalgique tourné vers le passé, mais d’une parole résolument ancrée dans le présent. Car les questions qu’il pose à travers ses récits — sur l’exil, la dignité, le sacrifice, la solitude, l’effacement — sont profondément actuelles. Ses personnages, réels ou fictionnels, traversent l’Histoire avec leurs blessures, mais aussi avec une force silencieuse qui fait écho aux tensions contemporaines : celles d’un pays en quête de mémoire, d’une jeunesse confrontée à l’oubli, d’une culture populaire souvent marginalisée.
L’écriture de Saïd Saad est donc un pont : entre générations, entre récits individuels et mémoire collective, entre les douleurs du passé et les défis du présent. Elle nous rappelle que la littérature n’est pas seulement un art, mais un devoir — celui de nommer ce que le silence ne doit pas enterrer.
Brahim Saci