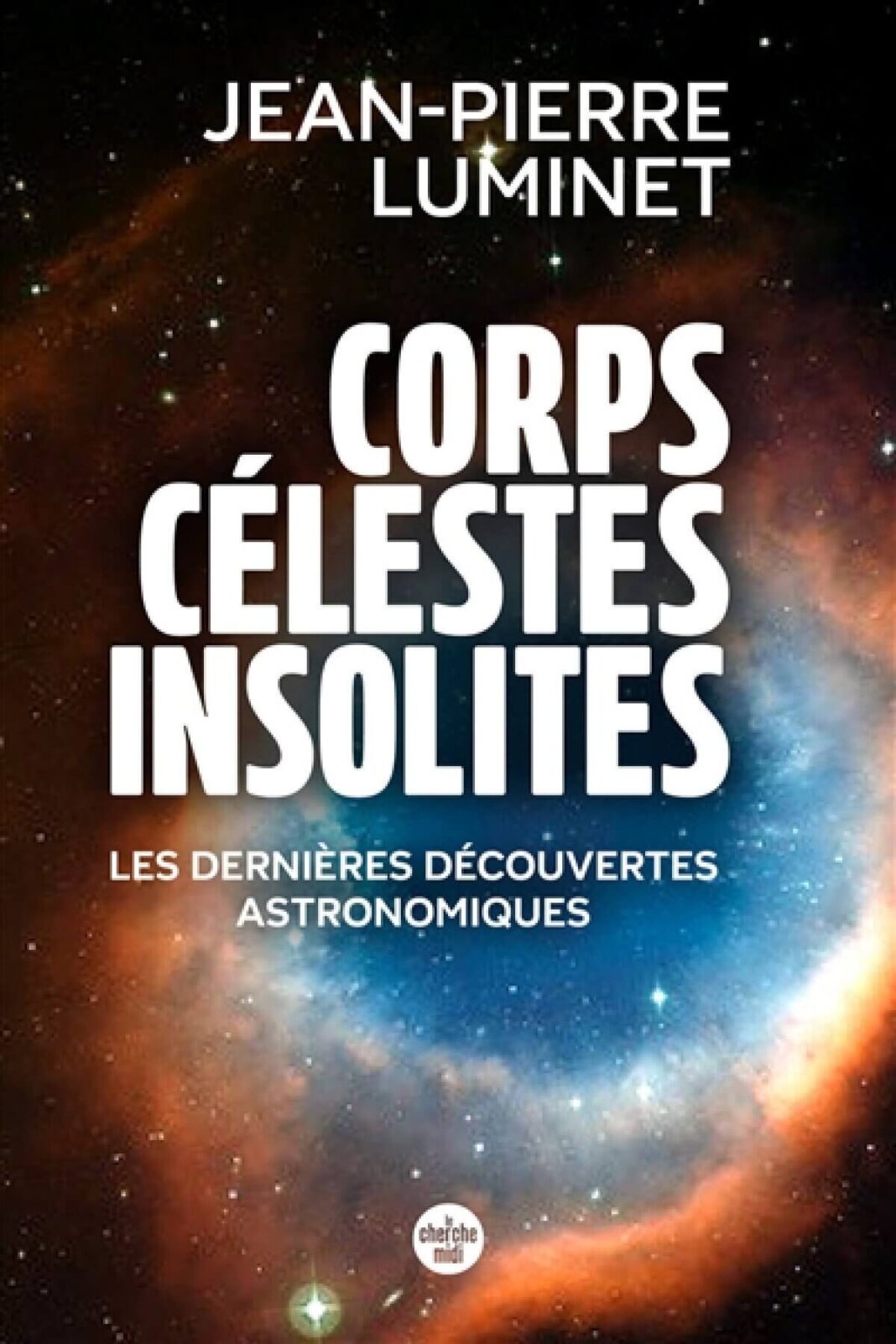Dans « Moi, Vincent Van Gogh, artiste peintre », publié par les éditions Le Passeur, Philippe André accomplit une entreprise aussi audacieuse que délicate : incarner de l’intérieur une conscience en feu, celle de Van Gogh, en reconstituant une parole intime, continue, urgente.
Il ne s’agit pas simplement de faire revivre un peintre mythique ou de donner chair à une figure historique, mais bien de restaurer une voix confisquée par la postérité, et par les interprétations souvent figées qu’on a plaquées sur lui : celle du fou génial, de l’artiste maudit, du martyr incompris.
Le roman se déploie dans un cadre restreint mais chargé de sens : les derniers mois de Van Gogh à Auvers-sur-Oise, peu avant sa mort en 1890. Ce temps suspendu, ce seuil, devient un espace littéraire d’une intensité extrême. Le choix de la première personne n’est pas seulement stylistique : c’est un geste d’écriture profondément éthique. Il engage l’auteur dans une forme de dépossession de soi, pour se mettre au service d’une parole autre, éclatée, douloureuse, mais nécessaire. En cela, le roman ne se contente pas de raconter : il fait entendre. Et c’est sans doute là sa plus grande force.
Philippe André, psychiatre de métier, n’exploite jamais ses connaissances pour pathologiser Van Gogh. Il en use pour habiter l’épaisseur de son trouble, en refusant toute réduction.
La souffrance du peintre n’est pas présentée comme un symptôme, mais comme un tissu complexe dans lequel se mêlent l’hypersensibilité, l’épuisement, l’isolement, la quête de lumière, et une spiritualité sans dogme. La folie, si elle est présente, est plus le miroir du monde que de l’individu lui-même. Ce que montre le roman, c’est à quel point Van Gogh n’était pas hors du monde, mais au contraire en contact brûlant avec lui, à vif, sans les filtres qui protègent la plupart des hommes.
L’écriture épouse cette tension permanente. Elle avance par bouffées, par éclats, par mouvements irréguliers qui rappellent parfois le pinceau nerveux du peintre. Il y a dans le rythme du texte une inspiration picturale, comme si la phrase elle-même cherchait à restituer des coups de brosse, des strates de lumière, des tourbillons d’ombre. Ce n’est pas une prose linéaire, mais une matière vivante, accidentée, émotive. À travers cette écriture, le roman réussit une chose rare : faire de la littérature un prolongement de la peinture, non pour l’illustrer, mais pour en épouser la nécessité.
Le dialogue entre Van Gogh et le docteur Gachet structure la narration, mais ce n’est pas un échange véritablement dialectique. C’est plutôt un espace de projection, d’affrontement avec le regard de l’autre, et peut-être de dernier recours face à la tentation du silence. Le docteur incarne une figure de réceptacle, mais aussi de limites : il écoute, mais ne peut pas sauver. Là encore, le roman évite tout pathos. Il ne cherche pas à attendrir ou à réhabiliter. Il montre la dignité tragique d’un homme qui choisit de continuer à peindre alors que tout, en lui et autour de lui, s’effondre.
Ce roman apporte quelque chose de singulier à la littérature inspirée de la vie des artistes : il ne vise pas à documenter ou à expliquer, mais à restituer une expérience vécue de l’intérieur. Ce n’est pas l’homme public ou le peintre de musée que l’on croise ici, mais une subjectivité nue, incandescente, obsédée par la couleur, le mouvement, la terre et le ciel. En cela, Philippe André donne un contrepoint essentiel à la construction muséale de Van Gogh. Il lui rend son inachèvement, son errance, sa fatigue. Mais aussi, et surtout, son courage créateur, ce qui en lui résiste au désespoir par l’acte même de peindre.
Et c’est précisément là que réside l’apport profond d’un tel livre. Il ne s’adresse pas seulement à ceux qui aiment Van Gogh ou la peinture : il interpelle quiconque s’interroge sur ce que signifie vivre en artiste, affronter la solitude, créer malgré l’effondrement. En redonnant chair à une voix longtemps étouffée sous le poids des mythes, Moi, Vincent Van Gogh propose une expérience unique à la croisée de deux univers — celui de la peinture et celui de la littérature. Cette immersion sensorielle et psychique invite à penser autrement la création : non comme ornement ou divertissement, mais comme nécessité vitale.
Dans un monde souvent distrait, saturé d’images mais avide de sens, ce roman agit comme un retour à l’essentiel. Il rappelle que toute œuvre vraie naît d’un lieu de tension extrême, et que l’art, loin d’être une consolation, est parfois un cri. C’est en cela que Moi, Vincent Van Gogh dépasse son sujet : il devient un voyage intérieur dans ce que la création a de plus absolu, de plus nu, de plus humain.
Brahim Saci