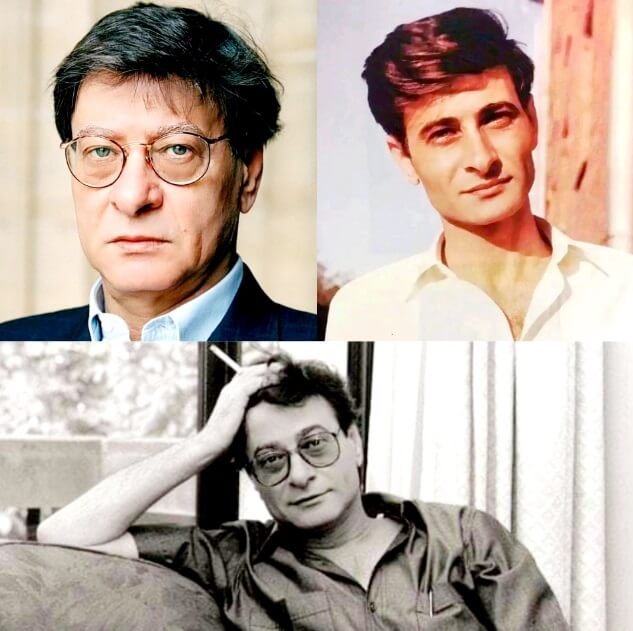Didier Aubourg retrace ici le parcours de Mahmoud Darwich, un poète qui a transformé la perte en beauté, la mémoire en résistance et qui a fait de l’exil une patrie de mots.
« Nous avons un pays de mots. Parle, parle que je pose ma route sur une pierre. »
Quand la terre se dérobe, il reste la langue. Darwich a fait de la poésie une patrie.
L’homme arraché
Mahmoud a sept ans. Une nuit, la famille fuit Birwa, son village de Galilée. Quelques semaines plus tard, le village n’existe plus. Rasé. Effacé des cartes. L’enfant reviendra, mais en étranger sur sa propre terre, désormais classé « présent-absent » par l’administration israélienne. Un oxymore bureaucratique qui contient déjà toute sa poésie.
Il grandit à Haïfa, écrit ses premiers poèmes, découvre qu’il possède une arme que personne ne peut lui confisquer : la langue arabe. Chaque vers devient un acte de présence. Chaque mot, une façon de dire : je suis encore là.
Puis ce sera l’exil permanent. Le Liban, Le Caire, Moscou, Paris, Tunis, Amman. Une vie de départs, de valises jamais vraiment défaites, de chambres d’hôtel où l’on finit par écrire les plus beaux poèmes. Darwich n’a jamais cessé de partir. Et pourtant, toute son œuvre dit : je reviens, non vers un lieu, mais vers une mémoire impossible.
Car l’exil, chez lui, n’est pas seulement géographique. Il est temporel. On peut revenir sur une terre ; on ne revient jamais dans un temps. L’enfance de Birwa est perdue à jamais. Le goût des figues du jardin, la voix du père appelant au crépuscule, l’odeur de la pluie sur la pierre chaude. Il ne reste que les mots pour en garder la trace.
La terre comme blessure et comme chant
La Palestine de Darwich n’est pas seulement un territoire disputé. C’est une métaphore de toute perte, de tout arrachement. Quiconque a perdu un pays, un amour, une innocence peut lire Darwich et s’y reconnaître.
Mais cette terre n’est jamais abstraite. Elle est charnelle, odorante, nourricière. Olivier, figuier, pain, mère. Les images reviennent, obsédantes, comme des fantômes familiers. La poésie de Darwich sent la terre retournée, le café du matin, le linge qui sèche au vent. On y entend le bruit des jarres qu’on remplit à la source, le froissement des robes des femmes qui préparent le repas. C’est un exil qui a gardé toutes les textures de ce qu’il a perdu.
Chez Darwich, la mère et la terre se confondent. Perdre l’une, c’est perdre l’autre. Et les retrouver toutes deux dans le poème, c’est refuser que la perte ait le dernier mot.
La terre parle, et parfois elle se referme.
« La terre nous est étroite. Elle nous accule dans le dernier passage et nous nous dépouillons de nos membres pour passer. »
Cette étroitesse n’est pas seulement celle de la Palestine. C’est celle de toute existence humaine confrontée à l’inacceptable. Darwich a transformé une tragédie particulière en chant universel, non en gommant sa singularité, mais en l’approfondissant jusqu’à toucher ce fond commun où toutes les souffrances se reconnaissent.
Résister par la beauté
On a souvent voulu faire de Darwich un poète militant. Il l’a été, jeune homme, quand il écrivait :
« Inscris : je suis arabe Et le numéro de ma carte est cinquante mille »
La colère était là, brute, frontale. Le poème fut interdit, Darwich assigné à résidence. Le prix à payer pour avoir dit je suis. Mais toute son œuvre ultérieure a consisté à dépasser cette colère. Non pas l’oublier : la transmuer.
Darwich a refusé le slogan, le tract versifié, la poésie de circonstance. Sa résistance est passée par la beauté. Par la complexité. Par le doute même, parfois. Il a écrit des poèmes d’amour au milieu du désastre. Il a célébré la vie quand tout invitait à ne chanter que la mort.
« Nous aimons la vie si nous y trouvons un chemin Nous dansons entre deux martyrs et nous érigeons un minaret pour la violette ou pour les palmiers, entre deux martyrs. »
Écrire un poème parfait, c’est déjà prouver qu’on n’a pas été effacé.
La beauté devient alors la forme suprême de la résistance. Jamais l’oubli de l’injustice : son dépassement par le haut. Là où l’oppresseur veut réduire au silence, le poète répond par un surcroît de langue, de rythme, de splendeur. Il oppose à la violence du fer la violence plus grande encore de la grâce.
« Nous avons sur cette terre ce qui mérite vie », ce vers, devenu célèbre, n’est pas un déni de la souffrance. C’est un refus de lui laisser le dernier mot.
L’héritage : les encriers qui se vident pour remplir le vide
Darwich est mort à Houston en 2008, le cœur fatigué d’avoir trop battu. Trois opérations, une vie d’errance, soixante-sept ans à porter un pays sur ses épaules. Mais sa voix n’a jamais été aussi présente.
Gaza, 2024. Ses vers circulent sur les réseaux sociaux comme des prières laïques. Des jeunes qui n’étaient pas nés à sa mort récitent ses poèmes dans les décombres. « La terre nous est étroite », jamais ce vers n’a sonné aussi vrai. Les hôpitaux bombardés, les familles ensevelies, et toujours cette parole qui refuse de se taire.
Car c’est cela, l’héritage d’un poète : non pas une œuvre figée dans les anthologies, mais une voix qui continue de parler quand les vivants n’ont plus de mots. Darwich n’appartient plus seulement à la Palestine. Il appartient à tous ceux qui, quelque part dans le monde, cherchent les mots pour dire l’injustice sans y perdre leur humanité.
D’autres poètes, aujourd’hui, prolongent ce geste. Ils vident leur encrier pour remplir le vide du monde. Ils savent, comme Darwich le savait, que la poésie ne sauve pas, mais qu’elle témoigne. Et que témoigner, c’est déjà résister.
« L’encrier qui se vide / Remplit le vide » : ce vers de Brahim Saci, dans son recueil La nuit retient l’aube, semble faire écho à Darwich par-delà les années. Même combat. Même foi dans la parole. Même conviction que l’exil, qu’il soit géographique ou intime, ne peut rien contre celui qui écrit.
L’encrier contre l’effacement
Darwich a passé sa vie à nommer ce qui avait été effacé. Les villages rasés, les oliviers arrachés, les morts sans sépulture. Chaque poème était un acte de mémoire contre l’amnésie organisée. Là où les bulldozers avaient passé, il replantait des mots. Là où les cartes mentaient, il rétablissait la vérité d’un nom.
Birwa. Jaffa. Haïfa. Ces noms reviennent dans ses poèmes comme des litanies. Pas pour ressasser. Pour empêcher l’oubli de gagner.
Mais il a fait plus que commémorer. Il a créé. Il a ajouté au monde une beauté qui n’existait pas avant lui. Des métaphores que personne n’avait trouvées. Des rythmes que l’arabe n’avait jamais portés ainsi. Et cette beauté-là, personne ne peut la raser. Elle est entrée dans la langue pour toujours.
On peut détruire un village. On ne détruit pas un vers.
L’exil lui a tout pris, sauf l’encrier. Et l’encrier a tout reconstruit.
Didier Aubourg
Les citations de Mahmoud Darwich sont données dans des traductions françaises courantes.