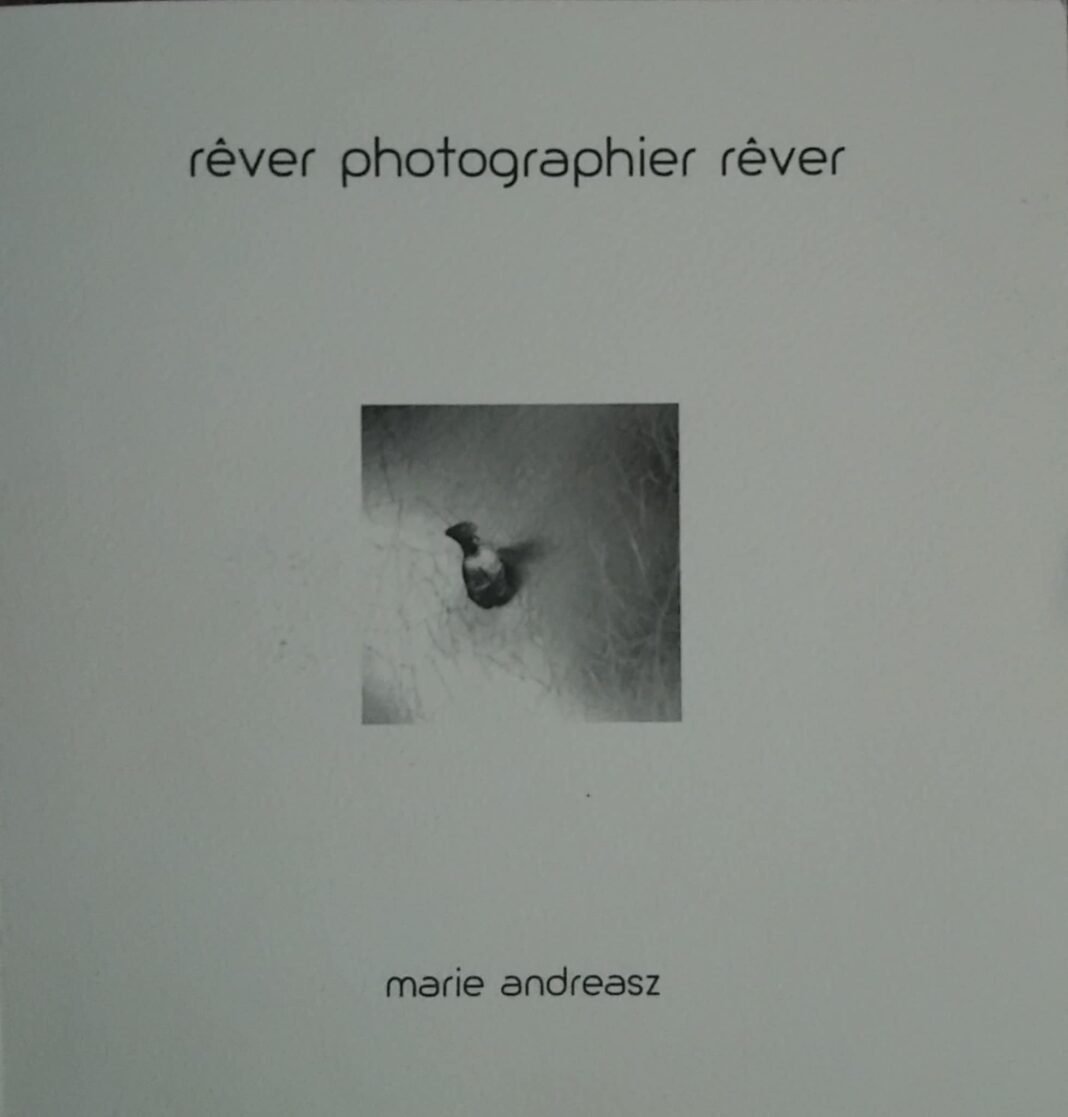Le livre Rêver, photographier, rêver de Marie Andreasz propose une immersion profonde dans un univers visuel où le temps semble suspendu. À travers ses images, il invite à ralentir, à écouter le murmure des objets simples et à renouer avec une mémoire intime, presque oubliée.
Le recueil Rêver, photographier, rêver de Marie Andreasz dépasse le simple album photographique : c’est une expérience sensible, une promenade au cœur de la lumière et du silence, portée par une main délicate et une vision poétique. Il s’affirme comme une voix singulière dans le paysage photographique contemporain. Il ne cherche ni à dénoncer, ni à illustrer. Il évoque, murmure, touche l’âme par la lumière. Marie Andreasz rêve ses images longtemps avant de les photographier. Dans le plus grand silence, attentive autant à ce qui surgit dans la lumière crépusculaire qu’à sa vision intérieure, elle capte des vies obscures et silencieuses, des objets que n’éclaire aucune lumière venue du dehors. Ses formes ne relèvent ni de l’imitation ni de la représentation. Elles naissent d’un regard enfoui, d’un enchantement rare : celui de croire encore que le monde peut apparaître, humblement, depuis l’intérieur. La photographie devient un espace d’écoute, un lieu de lenteur, un retour à soi — un abri, un chant silencieux, une terre intérieure.
Deux mots s’enlacent comme un écho, une boucle douce, une respiration. Cette formule trace une promesse : celle d’images surgies du silence, nées d’un monde intérieur, où le réel s’efface peu à peu pour laisser apparaître des empreintes sensibles. Le travail de Marie Andreasz s’inscrit dans un subtil équilibre entre perception et réminiscence, entre lumière retenue et ombre habitée. À travers le noir et blanc argentique, elle compose un univers suspendu, hors du temps, où chaque image semble émerger d’un rêve ancien, d’une mémoire enfouie, d’un regard tourné vers l’intime. À rebours des objectifs et boîtiers avides de lumière, elle retire toute trace solaire qui viendrait désigner, expliquer ou trop montrer.
Chez elle, la lumière ne vient pas du dehors : elle émane des objets eux-mêmes, comme une lueur intérieure, discrète, sacrée. Dans sa préface du livre Rêver, photographier, rêver de Marie Andreasz, Philippe André nous offre une méditation poétique et critique sur cette œuvre, où la lumière, le silence, le rêve et la perception intérieure dominent la réalité objective et documentaire. Le tirage manuel sur papier baryté confère à ces photographies une matérialité presque tactile. Le grain, la densité des ombres, les blancs diaphanes composent un langage visuel empreint de silence et de matière. Les objets photographiés — un bol d’eau, une cloche, des chaussures suspendues, des fleurs fanées — ne relèvent pas du spectaculaire. Ils sont modestes, parfois usés, mais transfigurés par une lumière rare, qui semble jaillir de l’objet lui-même plus que d’une source extérieure.
| À LIRE AUSSI |
| Marie Andreasz et Thierry-Hugues Lemaître : explorer l’espace entre photographie, poésie et méditation |
Un espace de silence dense
Les photographies de Marie Andreasz nous plongent dans un espace de silence dense, un territoire suspendu entre lumière et ténèbres, où les objets ne sont plus tout à fait ce qu’ils semblent être. Dans cette série, le regard s’arrête sur des fragments d’os, des crânes humains et animaux, un masque, un cercle de lumière — autant de formes arrachées au flux ordinaire du réel et déposées dans un écrin d’ombre et de mystère. Chaque image semble émaner d’un songe ancien, comme si la photographe avait saisi non ce que le monde montre, mais ce qu’il murmure.
Un crâne posé dans l’obscurité, cerclé d’un arc lumineux, évoque un rituel muet. Cette lumière ténue ne vient pas du dehors : elle semble naître de la matière même, comme un souffle d’âme. Rien de morbide ici. Ce n’est pas la mort qui s’impose, mais une présence silencieuse, humble, presque sacrée. Le crâne devient icône, relique, fragment de mémoire. On ne sait plus s’il est encore là ou déjà ailleurs, offert à notre contemplation lente.
Plus loin, deux crânes — humain et animal — dialoguent dans une composition verticale. L’un semble veiller sur l’autre, dans une architecture de regards absents. Il ne s’agit pas d’opposer nature et culture, mais de suggérer leur connivence souterraine, leur entente silencieuse. La photographie devient un seuil où les règnes s’enlacent, où l’humain retrouve son humilité face à ce qui l’a précédé et survivra à sa disparition.
Le grand crâne de cerf, cornes déployées, nous regarde de face. Il est là, massif, comme un totem. À la fois majestueux et fragile, il résiste au temps, suspendu dans l’ombre, éclairé par une lumière sourde. Il ne parle pas, mais impose sa présence. Il incarne cette densité du visible que seule la photographie argentique peut encore traduire dans sa pleine matérialité. C’est une apparition sans cri, une forme ancestrale, une trace.
Enfin, un crâne humain dialogue avec une figure énigmatique — peut-être un masque, peut-être un objet rituel, flou dans ses contours. La lumière coupe l’image en deux, posant une frontière invisible entre le monde tangible et un espace mental, intérieur, presque onirique. Les objets semblent venir d’un autre temps, ou d’un autre rêve. Rien ne s’impose, tout se suggère. Le regard glisse, hésite, revient. Ce n’est pas une image à comprendre, c’est une présence à ressentir.
Dans toutes ces photographies, Marie Andreasz ne cherche pas à choquer ni à illustrer. Elle évoque, murmure, laisse place à l’interprétation lente, à la rêverie. Elle ne photographie pas la mort, mais ce qui subsiste après le cri : le souffle, l’écho, l’empreinte. Elle donne à voir ce qui, sans la photographie, resterait dans l’ombre — ces restes qui disent l’existence, ces objets qui portent en eux une mémoire sans mots. La lumière est rare, précieuse, retenue. Elle sculpte plus qu’elle n’éclaire.
« Aspiration tenace à retrouver notre Heimat »
Ce travail impose un ralentissement du regard, une forme d’écoute intérieure. Ce n’est pas le visible qui compte, mais ce qui affleure. Il ne s’agit pas de figer le réel, mais de l’approcher, de le caresser du regard. Les photographies de Marie Andreasz deviennent ainsi un espace de recueillement — un lieu de passage entre le tangible et l’intime, entre le visible et ce qui échappe. Elles convoquent une mémoire enfouie, une sensibilité ancienne, un état de présence rare. En cela, elles offrent une véritable expérience : celle de contempler, dans le plus grand silence, ce que le monde a encore à nous dire.
Cette lumière intime, contenue, chuchotée, n’impose rien : elle invite, évoque un monde intérieur, murmure plus qu’elle ne montre. Comme le suggère Philippe André, les images de Marie Andreasz nous désorientent doucement, jusqu’à ce que ne subsiste que cette « aspiration tenace à retrouver notre Heimat », cette terre natale intérieure que chacun porte en soi, mais qui souvent nous échappe. La figure humaine est absente de manière explicite, mais sa présence s’impose partout : dans une empreinte, un geste suspendu, une forme sculptée, un reflet fragile. L’humain apparaît en creux, à travers la solitude paisible qui traverse les murs texturés et les fonds neutres, véritables surfaces mentales où se projettent des éclats de mémoire. Chaque composition, centrée sur un objet ou un détail, impose un ralentissement du regard, une pause contemplative. La répétition de certains motifs installe une sensation de boucle, un rituel discret, semblable à un rêve obstiné revenant sans cesse. Ces photos ne décrivent pas, elles suggèrent.
Elles touchent à ce qui échappe aux mots, à cette zone floue entre présence et absence, entre le tangible et l’évanescent. Elles invitent à percevoir au-delà du visible : une mémoire enfouie, une émotion légère, une vibration intime. Le titre même de la série — rêver, photographier, rêver — agit comme un souffle, un passage d’un état à un autre ; pour Marie Andreasz, photographier n’est pas figer, mais révéler. Non pas capturer, mais écouter ce qui, sans la photographie, resterait dans l’ombre. Ce travail porte en lui le désir d’un retour, celui d’un havre personnel, une terre natale intérieure, non géographique. Ce terme allemand, chargé d’affect et de mémoire, désigne un refuge, un lieu intime vers lequel les images semblent tendre.
Le regardeur est invité à s’y abandonner, à perdre ses repères pour mieux entendre les bruissements, les silences, les respirations ténues qui traversent chaque photographie. Un territoire où, comme l’écrit Philippe André, « le temps et l’espace de Marie imprègnent les nôtres de silence, de musiques, de bruissements épars, de résonances, d’échos, de voix intérieures, de fragments imperceptibles… et jusqu’à rien. » La série devient un sanctuaire visuel, un espace de recueillement où les objets les plus simples acquièrent une valeur presque sacrée. À la frontière du visible et du sensible, Marie Andreasz construit une œuvre qui ne se regarde pas seulement : elle se ressent. Elle crée un territoire de lenteur, une solitude habitée, où chaque image résonne avec notre propre intériorité. Elle rêve ses images avant de leur donner naissance, et nous offre la possibilité, en les contemplant, de rêver à notre tour. « Enchantement, vous dis-je ! » conclut Philippe André. Et il disait vrai.
Le chant silencieux d’un monde intérieur
Car cette œuvre ne se contente pas de séduire ou d’émouvoir : elle questionne. Elle interroge notre rapport au souvenir, au silence, à la trace. Elle réinvente la photographie comme un art de la retenue, de la nuance, du retrait. À contre-courant du flux saturé et immédiat d’images qui nous entoure, Rêver, photographier, rêver de Marie Andreasz prend le temps d’écouter ce qui ne se montre pas, d’éclairer ce qui demeure enfoui. En cela, l’œuvre exerce un impact profond, presque thérapeutique : elle propose un ralentissement, une réconciliation avec le sensible, une attention renouvelée à l’infime, à l’essentiel.
Marie Andreasz s’impose comme une présence unique et profondément personnelle au sein du paysage photographique contemporain, où tant d’œuvres se livrent à la surenchère visuelle ou à la narration explicite. Refusant la posture de dénonciation ou de simple illustration, son travail se déploie dans une forme de délicatesse et de retenue, où chaque image devient une invitation discrète à la contemplation.
Par la lumière subtile qu’elle manipule, elle touche directement l’âme, éveillant des émotions silencieuses, presque imperceptibles, mais d’une intensité bouleversante. Sa photographie ne s’apparente pas à un discours imposé, mais à un espace d’écoute attentif, un sanctuaire où le regardeur est invité à ralentir, à suspendre le temps, et à se reconnecter à son intériorité. C’est un lieu où l’on peut déposer ses tensions, loin du tumulte du monde extérieur, et retrouver un souffle profond, une respiration calme.
Chaque image agit alors comme un refuge, un abri protecteur qui enveloppe, apaise et offre un ressourcement. Ce travail se fait le chant silencieux d’un monde intérieur, une mélodie muette que seul le regard sensible peut entendre. Au centre de cette démarche se trouve un véritable voyage intérieur, un retour profond à soi-même, qui dépasse largement la simple captation visuelle.
La photographie s’élève ici en un lien fragile et puissant vers une terre d’âme, un espace de réconfort émotionnel — ce refuge personnel empreint de souvenirs et de ressentis profonds. Marie Andreasz ne se contente pas de présenter des images : elle déploie un espace à la fois poétique et spirituel, une invitation délicate à plonger dans le rêve, à accueillir les émotions, et à se reconnecter avec soi-même sous le voile d’une lumière habitée, empreinte de mystère et de douceur.
Brahim Saci